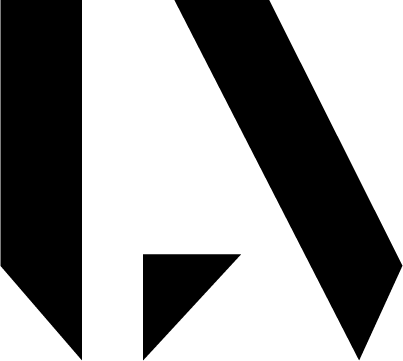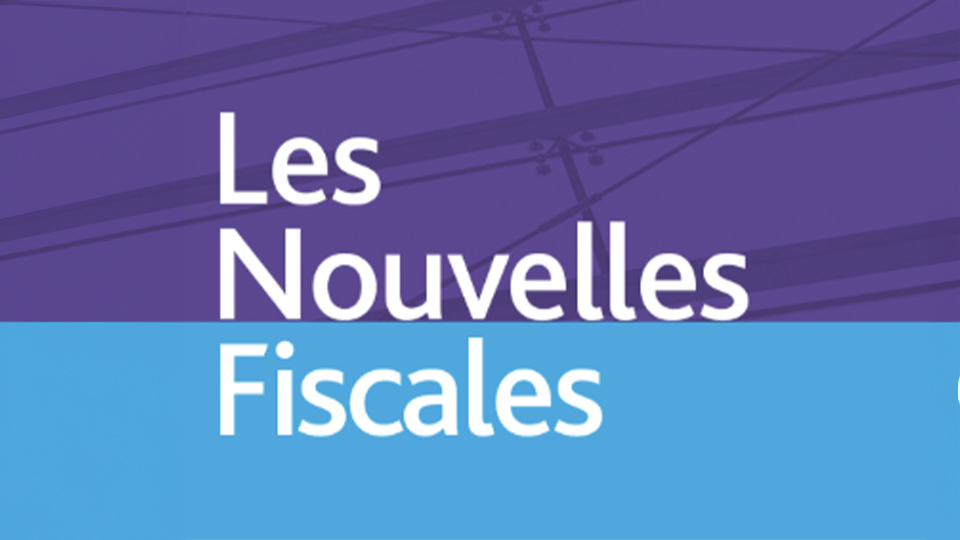
“Moins nous possédons et plus nous pouvons donner” affirmait Mère Thérésa : cette pensée, pour juste qu’elle puisse être dans l’ordre spirituel, est contredite par l’appréciation, dans l’ordre temporel, que l’administration fiscale fait du présent d’usage. Noël est l’occasion de rappeler que la doctrine administrative¹ admet de ne pas appliquer les droits de mutation à titre gratuit « aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage au sens de l’article 852 du Code civil. Cet article (…) précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant. » Ainsi, pour être qualifié de présent d’usage, un don manuel doit être lié à un « événement » et ne pas être « disproportionné » par rapport au patrimoine de celui qui offre ce présent. Avec deux critères aussi subjectifs, on devine l’embarras du juge judiciaire, saisi de contentieux plus souvent civils que fiscaux, lorsqu’il s’agit de séparer le bon grain de l’ivraie.
S’agissant de l’événement, la jurisprudence a pu retenir la qualification de présent d’usage pour des cadeaux intervenant à l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire, d’une naissance, d’un succès scolaire ou social, des fêtes de fins d’année ou de fêtes religieuses². Comme le précisait Guy Venandet il y a déjà presque 30 ans³, aucun critère objectif ne saurait cerner infailliblement l’événement à l’origine du don : il varie selon les époques, les régions, les univers, les familles, les croyances. C’est donc en sociologue qu’il convient d’apprécier si la Saint-Valentin, une promotion, une cérémonie confessionnelle ou l’obtention d’un diplôme constituent aujourd’hui des événements à l’occasion desquels la société reconnaît qu’il est d’usage que les proches, les amis ou la famille expriment leur gratitude ou leur affection. Les usages d’aujourd’hui sont-ils les mêmes qu’il y a 30 ans ? Il est permis d’en douter…
L’existence d’un usage n’est toutefois guère suffisante : encore faut-il que la valeur du présent ne soit pas significative pour celui qui se dessaisit. Ce n’est plus en sociologue mais en comptable que le juge doit apprécier, au cas par cas, si le présent est ou non modique au regard des ressources du donateur. Et, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la tâche est tout aussi difficile. Le juge adopte parfois une approche dynamique, en comparant la valeur du don aux revenus du disposant. Ainsi, au contentieux, l’administration fiscale, qui s’est toujours – on la comprend ! – refusée à officialiser une règle de proportionnalité, a pu soutenir que la ligne jaune entre modicité et appauvrissement pouvait être tracée autour de 2,5% du revenu annuel du donateur⁴, en se basant sur une décision de Cour d’Appel⁵. Pourtant, des cadeaux représentant plus de la moitié des revenus annuels du donateur ont pu être jugés modiques⁶ ! On l’aura compris : il est vain de vouloir tirer de la jurisprudence des enseignements arithmétiques. Notons toutefois que le juge semble privilégier le plus souvent une approche statique, en comparant la valeur du don à celle de la fortune du donateur. C’est ainsi que plusieurs dons intervenus le même jour ont été considérés comme modiques, alors qu’ils représentaient 2,44% de la fortune du disposant⁷.
En cette période de fêtes, on retiendra que pour que la générosité puisse s’exprimer en franchise d’impôt, tout est affaire de contexte…
1 – RES n° 2013/05 (ENR) : BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, § 260.
2 – Voir I. Najjar, Rép. Civ. Dalloz, V° Donations, p. 18.
3 – note sous Cass. 1re civ., 6 déc. 1988 : JCP N 1989, II, p. 305 et s., spéc. p. 307.
4 – Daniel FAUCHER, « Présents d’usages non imposables », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 51, 20 Décembre 2002, 1724.
5 – Cour d’appel de Bordeaux, 1re ch., 9 avril 1987, n° 3515/85.
6 – Cour d’appel de Nancy, 5 février 2007, n° 04/01431 et confirmé par Civ 1, 15 mai 2008 n° 07-13.947.
7 – Cour d’appel de Paris, 11 avril 2002 ; RG n°2001/0379 ; RJF 11/02 n°1327.

Bertrand Lacombe
Avocat à la Cour, Lacombe Avocats